Cahier thématique n°19 - L’Ordre et ses missions
02. LES MISSIONS DE L'ORDRE
Assurer le respect des devoirs professionnels
08/12/2021
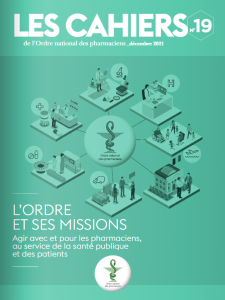
L’exercice pharmaceutique confère des droits, mais aussi des devoirs et une haute exigence dans la pratique du métier de pharmacien. C’est pourquoi les fautes commises par le pharmacien pendant l’exercice de son métier peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. Une compétence juridictionnelle, essentielle pour préserver la confiance des patients, exercée par ses pairs et encadrée par des magistrats professionnels, est confiée à l’Ordre.
La conciliation et l’instruction des plaintes disciplinaires, une garantie pour le patient… et le pharmacien
> L’activité disciplinaire
Elle est une mission essentielle. Les manquements au code de déontologie (articles R. 4235-1 à 4235-77 du code de la santé publique) et aux règles d’exercice professionnel relèvent des chambres de discipline et, s’ils sont établis, peuvent faire l’objet d’une sanction.
La responsabilité professionnelle d’un pharmacien ne requiert pas un élément intentionnel pour être engagée. Il peut s’agir d’une négligence ou d’une incompétence. L’ensemble des affaires portées devant les juridictions disciplinaires a permis de constituer une jurisprudence. Le pharmacien poursuivi est jugé par ses pairs qui exercent au quotidien cette profession.
> Qui peut adresser une plainte à l’Ordre ?
La liste des plaignants est déterminée par le code de la santé publique. Un particulier peut déposer une plainte, mais également un pharmacien inscrit au tableau. Dans ces deux cas, une conciliation préalable est organisée.
Une plainte peut aussi être déposée par les ministres chargés des Solidarités et de la Santé ou de la Sécurité sociale, par des directeurs généraux de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), et des agences régionales de santé (ARS). Le procureur de la République peut également introduire une plainte. Enfin, le président d’un des conseils de l’Ordre (Conseil national, Conseils centraux et régionaux) peut lui-même déposer une plainte.
> Comment ?
Un ou plusieurs conseillers ordinaux, désignés par le président du Conseil, organiseront la conciliation afin de tenter la résolution à l’amiable du litige né entre des pharmaciens ou à l’initiative d’un particulier. Si la conciliation est partielle, absente ou si elle échoue, la plainte est transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil qui désignera un autre conseiller comme rapporteur. La chambre de discipline, saisie après l’échec de la conciliation, ne prononce pas nécessairement une sanction disciplinaire ; elle peut rejeter la plainte. Il existe des cas dans lesquels la plainte peut être jugée abusive.
Par leur expérience professionnelle, les conseillers ordinaux qui siègent en chambre de discipline ont une meilleure compréhension des aspects professionnels des litiges qui leur sont soumis. Cela leur permet de mieux connaître les difficultés professionnelles rencontrées par leurs confrères.
En première instance, la plainte est introduite devant le Conseil – régional ou central – de l’Ordre compétent. La décision prise par la chambre de discipline des Conseils régionaux et centraux en première instance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de discipline du Conseil national, et la décision rendue à la suite de l’appel peut elle-même être soumise au Conseil d’État.
« Le pharmacien conseiller ordinal, lorsqu’il siège en chambre de discipline, devient un juge à part entière. Ceci a pour conséquence que la décision finale n’émane pas de l’Ordre mais d’une juridiction, entité autonome de l’Ordre, explique Martine Denis-Linton, conseiller d’État, présidente de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP). Le magistrat professionnel présidant la chambre dirige l’instruction du dossier avec le conseiller ordinal désigné comme rapporteur et avec l’appui indispensable des collaborateurs des services administratifs des conseils, de leurs juristes et du secrétariat. »
Au cours de l’audience, il préside les débats, puis, à leur issue, durant le délibéré, chaque membre de la chambre de discipline, y compris le président, dispose pour le vote d’une voix (celle du président étant prépondérante en cas d’égalité).
Les droits de la défense sont garantis : audiences publiques, respect du contradictoire, impartialité, assistance par un avocat ou un confrère inscrit au tableau, décision motivée en droit et en fait. Les conseillers ordinaux et les collaborateurs sont tenus au secret tout au long de la procédure, y compris après le délibéré. Les sanctions susceptibles d’être prononcées, et qui sont personnalisées, peuvent aller de l’avertissement à l’interdiction définitive d’exercer. Les sociétés d’exercice libéral peuvent également faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
L’élaboration du code de déontologie, une garantie pour le patient
Le CNOP est chargé, par le législateur, d’élaborer le code de déontologie qui correspond à l’ensemble des règles ou devoirs régissant la conduite à tenir et qui encadre l’activité professionnelle des pharmaciens inscrits au tableau. C’est une de ses missions historiques.
D’autres instances interviennent comme l’Autorité de la concurrence et le Conseil d’État, auquel le texte est soumis avant publication au Journal officiel.
Martine Denis-Linton,
Conseiller d’État, présidente de la chambre disciplinaire du CNOP

« Toutes les juridictions disciplinaires sont présidées par un magistrat. La coexistence d’un magistrat professionnel et de professionnels de la pharmacie constitue un bon équilibre qui assure l’impartialité de la justice, en évitant “un entre-soi intégral”. Elle est également justifiée par la complexité du droit qui nécessite parfois une expertise juridique pointue. Enfin, c’est au magistrat qu’il appartient de rédiger les décisions des chambres disciplinaires qui doivent être motivées en fait et en droit en se fondant sur l’application des dispositions législatives et réglementaires, et notamment du code de la santé publique, mais aussi de la jurisprudence. Le fait que ces juridictions spécialisées soient essentiellement composées de pairs (qui, en outre, sont tous en exercice, particularité de l’Ordre des pharmaciens) contribue à une meilleure acceptabilité des décisions rendues. »
