Bon usage des produits de santé : rapport de la Cour des comptes
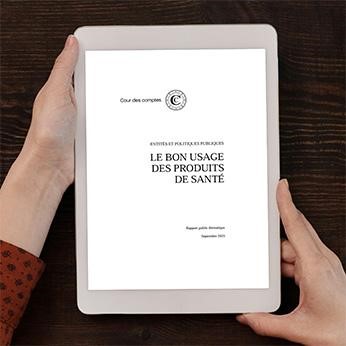
Dans son récent rapport, la Cour des comptes rappelle les multiples enjeux du bon usage des produits de santé. Elle y souligne la nécessité d’une meilleure connaissance de leur utilisation et recommande différentes actions pour contribuer au bon usage de ces produits. Focus sur les principaux constats et recommandations de ce rapport.
Le bon usage des produits de santé constitue un enjeu majeur, non seulement en termes de santé publique et de maîtrise des dépenses, mais aussi en raison de l’émergence de préoccupations environnementales et de la lutte contre les tensions d’approvisionnement.
Des situations de mésusage persistent, incitant à la vigilance les autorités sanitaires, en particulier dans le domaine des médicaments antalgiques, anti-infectieux, anti-ulcéreux œsogastriques et antidiabétiques. Il en est de même pour certains médicaments prescrits à des personnes présentant des facteurs de risque ou de vulnérabilité, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées. Enfin, la consommation de certains produits de santé apparaît durablement élevée, à l’image de la consommation d’antibiotiques alors même que la résistance grandissante des bactéries devrait inciter à en maîtriser l’usage.
Sur le plan environnemental, la présence de résidus issus des médicaments dans les eaux est généralisée.
En outre, l’approvisionnement en produits de santé connaît des tensions, voire des épisodes de pénurie pour certains d’entre eux.
Renforcer la connaissance des usages des produits de santé
La Cour des comptes constate une large méconnaissance des usages des produits de santé et souligne la nécessité de mieux connaître et maîtriser les modalités de prescription, de dispensation, et de comprendre pourquoi certains produits sont détruits sans avoir été utilisés.
À cet effet, elle recommande :
- de permettre ou d’améliorer l’identification dans les bases de données nationales de ses professionnels des établissements de santé à l’origine d’une prescription à la fois interne à l’établissement et à destination de la ville, par l’enregistrement de leur identifiant personnel RPPS ;
- de communiquer régulièrement aux établissements de santé les informations portant sur les pratiques prescriptives de leurs professionnels ;
- d’améliorer la connaissance des produits de santé jetés en réalisant, en ville, des études de caractérisation des déchets, et dans les établissements de santé, une remontée d’information centralisée par le biais d’indicateurs.
Promouvoir l’utilisation des systèmes d’information et leur interopérabilité
Le rapport souligne que les systèmes d’information ne contribuent encore que très partiellement au bon usage des produits de santé, leur développement et leur utilisation effective par les professionnels étant insuffisants.
Le dossier médical partagé (DMP) est encore trop peu consulté et alimenté par les professionnels de santé, y compris par les pharmaciens : les notes de vaccination, par exemple, n’y sont pas systématiquement déposées.
L’interopérabilité entre les systèmes d’information demeure encore trop limitée. La Cour recommande notamment d’intégrer dans le DMP du patient les données relatives aux médicaments dispensés figurant dans le dossier pharmaceutique (DP).
Intensifier les leviers d’actions auprès des prescripteurs libéraux
Il est notamment préconisé d’étendre les dispositifs d’accompagnement de la prescription mis en place pour les analogues du GLP-1 (remboursement conditionné au respect des indications thérapeutiques) ou pour les antalgiques de palier 2 (recours à des ordonnances sécurisées pour les médicaments à base de codéine ou de tramadol) à d’autres médicaments présentant un fort risque de mésusage.
Renforcer le rôle des pharmaciens
La Cour des comptes souligne le rôle décisif des pharmaciens d’officine dans la lutte contre l’antibiorésistance, via la réalisation des TROD angine et cystite. Elle préconise d’intensifier le recours à ces tests et d’inciter ainsi les patients à se rendre directement chez leur pharmacien.
Elle met en avant le rôle central des pharmacies à usage intérieur dans l’approvisionnement, la dispensation et le bon usage des produits de santé au sein des établissements de santé.
Elle pointe également la contribution des pharmaciens à la réduction des dépenses de santé via la substitution par un médicament générique, progressivement étendue aux médicaments biosimilaires.
Agir sur l’offre de produits de santé émanant des industriels
La Cour recommande de mener des actions avec les industriels, pour les inciter à adapter les conditionnements des produits de santé aux durées de prescription recommandées et à optimiser les délais de péremption.
Elle suggère d’inclure la question des conditionnements et des délais de péremption dans le cadre des négociations relatives à la tarification des produits de santé, au titre des conditions prévisibles et réelles d’utilisation.
Enfin, la production des produits de santé pourrait s’inscrire dans une perspective de développement plus durable. La Cour considère que la re-dispensation des médicaments non utilisés pourrait être envisagée, en particulier pour les médicaments onéreux. L’expérimentation d’une telle approche pour les médicaments anticancéreux délivrés en rétrocession hospitalière est actuellement envisagée par les administrations centrales chargées de la santé en France. Certains dispositifs médicaux pourraient également être soit réutilisés après stérilisation, soit réemployés après avoir été réparés ou remis en bon état d’usage, soit retraités ou recyclés.
