Cahier thématique n°20 - Lutte contre l’antibiorésistance, tous engagés
03. LES PHARMACIENS ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE L'ANTIBIORÉSISTANCE
Et demain ? Vers de nouvelles pistes de recherche
13/07/2022
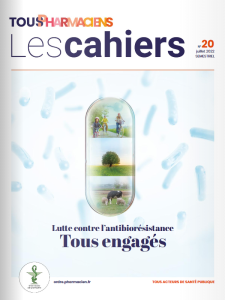
La menace que fait peser la progression de l’antibiorésistance sur la santé publique mondiale est aggravée par le faible nombre de nouveaux antibiotiques commercialisés depuis le début des années 2000. De plus, la durée moyenne de développement d’un nouveau médicament étant d’une dizaine d’années, il est urgent de prendre en compte les nouvelles substances ou techniques alternatives permettant de pallier les limites de l’arsenal antibiotique actuel.
-> Quels sont les produits en développement ?
Chaque année, l’OMS publie un rapport sur les antibactériens en cours de développement, que ce soit au stade clinique ou préclinique (68). Une attention particulière est portée aux agents susceptibles d’agir sur les germes pathogènes prioritaires, tels que Clostridium difficile ou Mycobacterium tuberculosis, aujourd’hui à l’origine d’impasses thérapeutiques.
En phase de développement clinique, ont ainsi été recensés :
- 43 molécules antibiotiques « classiques », dont seulement 7 sont innovantes et 2 sont actives sur les bactéries Gram négatif multirésistantes ;
- 27 agents non conventionnels, principalement actifs sur les bactéries Gram négatif multirésistantes :
- des anticorps monoclonaux ou polyclonaux,
- des bactériophages,
- des agents modulateurs du microbiote, surtout au niveau intestinal, et notamment pour traiter des infections à Clostridium difficile.
Au total, l’OMS considère que l’éventail des antibiotiques récemment commercialisés ou au stade du développement clinique est insuffisant pour relever le défi de l’antibiorésistance. En revanche, le pipeline préclinique est dynamique et innovant. La recherche de nouveaux antibiotiques comporte différentes approches, toutes d’utilité clinique potentielle : petites molécules à action directe, peptides antimicrobiens, vaccins, immunothérapie et nombreux médicaments non conventionnels…
-> Exemples de recherche translationnelle, menée en France, sur des médicaments non conventionnels
- Les bactériophages sont des virus spécifiques d’une bactérie, existant à l’état naturel, et qui peuvent conduire à sa lyse. Aux Hospices civils de Lyon, et en collaboration avec l’institut Pasteur, des pharmaciens hospitaliers réalisent des préparations magistrales d’une sélection de bactériophages, qui permettent de traiter, à titre compassionnel, des infections ostéoarticulaires à germes multirésistants (69).
- La transplantation de microbiote fécal (TMF) vise à reconstituer la flore intestinale d’un patient, en utilisant les selles d’un donneur sain. Elle est actuellement autorisée par l’ANSM pour différentes pathologies, dans le cadre d’essais cliniques. Mais la TMF peut déjà être employée dans le soin courant de malades atteints d’une infection récidivante à Clostridium difficile, sous forme de préparations magistrales réalisées dans les CHU sous la responsabilité de pharmaciens (70).
-> Structurer et coordonner les efforts de recherche
En France, un Programme prioritaire de recherche (PPR) sur l’antibiorésistance a été lancé au début de 2020 (71). La coordination de cette programmation scientifique et des financements se fait en lien avec les initiatives européennes. Une cartographie des acteurs académiques et industriels a été
réalisée, permettant de retrouver les équipes de recherche françaises concernées par la thématique de l’antibiorésistance, au sein d’un portail Internet commun (72).
(68) 2020 Antibacterial agents in clinical and preclinical development. WHO – 17 avril 2021.
(69) Centre de référence pour la prise en charge des infections ostéoarticulaires complexes (CRIOAc) de Lyon.
(70) ANSM, 21 janvier 2021.
(71) Programme prioritaire de recherche sur l’antibiorésistance. Inserm – 2020.
(72) Interface nationale Antibiorésistance : ppr-resistance.inserm.fr
